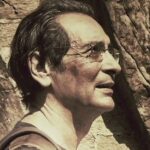Entre le souffle vital et la fièvre romantique, Tuberculinum est bien plus qu’un simple remède. C’est un souffle en mouvement, un appel au voyage et à la transformation intérieure. De ses racines médicales à sa portée symbolique, cet article en explore le trajet et la signification. Bernard Long
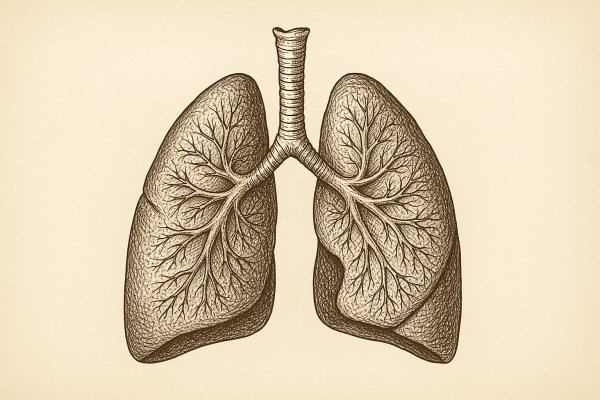
Sur cette page
- De quelle tuberculine s’agit’il ?
- D’autres tuberculines existent
- La tuberculose
- Jung et la « maladie pneumatique »
- Qu’est-ce que le pneuma ?
- Un malade pneumatique : agitation et imaginaire
- Voyages, exil, un vent d’alizé
- Art, sensibilité, un zéphir
- Sensibilités spécifiques
- Passion, amours et colère : la tempête
- Santé fragile : la « malaïgue »
- Conclusion
De quelle tuberculine s’agit’il ?
Lorsque l’on parle de tuberculinum en homéopathie, de quelle tuberculine s’agit-il ?
En 1879, Swan prépara à partir de crachats de tuberculeux un nosode qui fut appelé tuberculinum.
En 1890, Burnett, homéopathe anglais, utilisa des dilutions dynamisées de crachats et de broyats de poumon tuberculeux (préparées par le Dr Heath), appelées à l’époque bacillinum. Il en fit une pathogénésie clinique chez des patients tuberculeux et publia ses résultats dans The New Cure for Consumption.
À partir de 1897, la tuberculine de Koch fut employée à doses pondérales par l’école officielle, avec des résultats désastreux.
Kent utilisa une préparation de Boericke et Tafel à partir d’un ganglion tuberculeux bovin : c’est le tuberculinum bovinum expérimenté par Swan.
Le tuberculinum vendu en France aujourd’hui est le tuberculinum T.K., une tuberculine humaine, préparée avec la tuberculine brute de l’Institut Pasteur.
D’autres tuberculines existent
- Aviaire : nosode préparé à partir d’un poumon tuberculeux d’oiseau (Cartier).
- Tuberculinum residuum (T.R.) : obtenu par centrifugation ; tableau pathogénétique issu des réactions accidentelles à des injections intempestives de tuberculine résiduelle de Koch.
- Marmorek : sérum de cheval vacciné avec filtrat de cultures jeunes.
- Denys : bouillon de culture de BK filtré.
- Spengler : sang total de lapin immunisé à l’aide d’une culture de B.K.
- Bacillinum testium : préparé à partir d’orchite tuberculeuse.
- Friedmann : bacilles de la tortue de mer.
La tuberculose
La tuberculose est une maladie bactérienne due à plusieurs mycobactéries, dont la principale est le mycobacterium tuberculosis. Ces bactéries sont également appelées bacille de Koch (BK) en référence à Robert Koch qui mit en évidence ce bacille en 1882.
La tuberculose pulmonaire est la plus fréquente. Voici quelques formes extra-pulmonaires :
- Tuberculose ganglionnaire.
- Douleurs articulaires ou dorsales (si la tuberculose atteint la colonne vertébrale).
- Tuberculose cérébro-méningée.
- Formes thoraciques (atteinte tuberculeuse de la plèvre, de l’enveloppe du cœur).
- Formes abdominales (digestives, rénales, etc.).
- Fièvre traînante avec sueurs nocturnes, fatigue, perte d’appétit, amaigrissement.
Jung et la « maladie pneumatique »
Carl Jung qualifie la tuberculose de maladie psychopneumatique.
Dans une lettre du 19 décembre 1952 adressée à M. Campbell, il écrit :
« J’ai eu un certain nombre de patients atteints de tuberculose dans ma vie et des résultats vraiment excellents avec la psychothérapie. Mais il est vrai que le cas somatique moyen a généralement une résistance à l’approche psychologique, en particulier les patients atteints de tuberculose, puisque la tuberculose est, d’une certaine manière, une maladie « pneumatique », c’est-à-dire qu’elle affecte le souffle vivifiant. C’est dans de tels cas que le patient avait un orgueil et une obstination à défendre l’obtention d’une réponse somatique à un problème psychologique insoluble. »
(C.G Jung – Letters – Princeton University Press, 1975, p. 101)
Dans une autre lettre du 23 janvier 1960 adressée au Dr Swoboda, il ajoute :
« C’est pourquoi j’appelai, en plaisantant, la tuberculose une « maladie pneumatique », voyant que le soulagement psychique entraîne un changement radical d’attitude mentale. »
(C.G Jung – Letters – Princeton University Press, 1975, p. 533)
Qu’est-ce que le pneuma ?
Pneuma (πνεῦμα) est un terme grec qui signifie « souffle » :
- Souffle du vent
- Respiration, souffle de vie
- Exhalaison, odeur
- Souffle d’ardeur
Le terme peut aussi signifier esprit, âme dans un contexte religieux.
En Égypte ancienne : t3w n۱nh désigne le souffle de vie.
En hébreu : ruah signifie vent, souffle ou esprit, équivalent de pneuma.
En sanskrit : prāṇa intègre souffle et principe vital.
Dans la mystique tibétaine : le loung (souffle) est la monture et l’esprit le cavalier. Cette conception du souffle conjugué à l’esprit est éclairante. Elle permet de mieux comprendre les techniques du pranayama où l’adepte du vajrayana dompte le souffle pour l’apaiser au point de ralentir l’esprit et les pensées.
On saisit mieux l’idée jungienne de « maladie pneumatique » qui considère la tuberculose comme une maladie qui affecte à la fois la respiration et le psychisme du patient. Enfin, il ne faut pas oublier le rôle que Hippocrate attribuait à l’air dans l’épilepsie, ni le fait que le mistral a souvent été considérer comme un vent qui rend fou.
Un malade pneumatique : agitation et imaginaire
La tuberculose fut la grande pathologie du monde romantique.
Le romantisme, mouvement artistique et culturel né à la fin du XVIIIe siècle en Allemagne et en Angleterre, s’est diffusé dans toute l’Europe.
Un exemple : Chopin
Frédéric Chopin, atteint de tuberculose, incarne l’esprit romantique :
- Être tourmenté, hypersensible, passionné.
- Talent prodigieux au service d’une musique novatrice et délicate.
- Vie marquée par l’amour (notamment avec George Sand), l’exil, les voyages.
- Une existence en perpétuelle mobilité, géographique, sentimentale et créative.
Voyages, exil, un vent d’alizé
Le pneuma qui traverse tuberculinum peut se faire vent qui pousse au voyage. Le sujet est agité, hyperactif, ne reste pas dans la même position. Tuberculinum a besoin de grand air, il veut que les portes et fenêtres soient ouvertes. Ses douleurs sont erratiques dans les membres et les articulations. Il est amélioré par un mouvement continu.
Tuberculinum peut être précoce sut le plan mental mais plus faible sur le plan physique, c’est in impatient, impulsif. Sur le plan psychique, il a tendance à la cyclothymie. Il pourra alterner des phases d’exaltation avec des phases de dépression. Tuberculinum a la bougeotte, il veut le changement, il désire voyager, il rêve de voyages. Il est instable et veut toujours quelque chose de différent. Il peut être aventurier. Sa nostalgie d’un ailleurs peut le conduire dans un monde fictif, pouvant allant vers un comportement sectaire ou borderline.
Art, sensibilité, un zéphir
Un zéphir peut aussi traverser tuberculinum. Voici un tuberculinum bouleversé par une sensibilité à fleur de peau. Il est compatissant, sentimental. Il est amoureux passionné, parfois lascif mais vite épuisé. C’est une remède qui peut être extrêmement esthète, à la recherche de la beauté, un imaginatif brillant.
On le trouve chez un certain nombre d’artistes, particulièrement à la période romantique. Il passe de l’introversion à l’extraversion, de l’ennui à l’enthousiasme. Il est assez solitaire. L’émotion le saisit, il est au bord des larmes. La musique le bouleverse. C’est un idéaliste, facilement en révolte, supportant mal l’autorité d’autrui.
Sensibilités spécifiques
Les sensibilités caractéristiques de Tuberculinum se manifestent sur plusieurs plans :
- Climatique : aggravation par le froid humide, les changements de temps.
- Respiratoire : rhumes, bronchites, asthme, allergies.
- Sensorielle : hypersensibilité à la musique, aux bruits forts.
- Émotionnelle : émotions intenses, irritabilité, anxiété, peurs (chiens, orages).
- Cutanée : eczéma, démangeaisons nocturnes, éruptions.
Passion, amours et colère : la tempête
Tuberculinum subit une véritable tempête. Le pneuma s’affole et le sujet devient exalté. Cette bourrasque qui l’agite est doublée de peurs diverses. Il a peur des chiens et des animaux en général. Il a peur des chats Il a peur de l’orage, peur que quelque chose n’arrive.
Il est passionné. Sa passion s’exprime dans l’amour, dans le créativité, dans la véhémence. Elle peut se transformer en irritabilité, en colère. Tuberculinum devient irritable, tout le dérange et il peut éclater. Il se fâche, veut se battre, jette les objets à quiconque l’agace. Il ne supporte mas qu’on le regarde. Il est insatisfait et instable. Cet être obstiné se met en colère, se met à jurer, à détruire, il s’arrache les cheveux. Il désobéit, se montre parfois méchant.
Santé fragile : la « malaïgue »
Tuberculinum est sensible aux agressions de toutes sortes. La maladie guette tuberculinum. Cette fois le vent qui le traverse est un air malsain, une sorte de malaïgue. Il devient maladif. Les symptômes respiratoires sont abondants : toux sèche ou grasse et expectoration qui peut être épaisse, jaune, souvent vert jaunâtre, dans les catarrhes. Dyspnée, asthme.
Le sujet tuberculinum est un sujet fragile prend froid facilement, il attrape un nouveau rhume à la moindre exposition au froid, ne peut en finir un sans qu’un autre commence ; il maigrit alors qu’il va bien, qu’il mange bien ; parfois il doit se lever la nuit pour manger. Il aime alors une nourriture un peu grasse, la viande de porc, le lard, des viandes fumée, du lait froid.
Conclusion
Tuberculinum est un remède pneumatique, traversé par des vents, des airs, des souffles qui l’agitent, le font vibrer et parfois l’épuisent.
Octobre 2025
Important : il est possible que l’un des remèdes décrits sur ce site vous convienne, mais on ne peut l’affirmer sans un interrogatoire et un examen sérieux effectués par un médecin homéopathe. Le site est fait pour faire connaître l’homéopathie, en aucun cas il ne peut se substituer à un thérapeute. Le docteur Bernard Long n’assure plus de consultations.
Adresser un message à Bernard Long (Il ne doit pas concerner une consultation à caractère médical).
Bernard Long
Présentation du docteur Bernard Long
Ouvrages
- Symboles et archétypes en homéopathie, reprend un certain nombre d’articles publiés sur ce site et les complète.
- Le Répertoire homéopathique des maladies aiguës complète utilement cet ouvrage.
- L’enfant, la mère et l’homéopathie