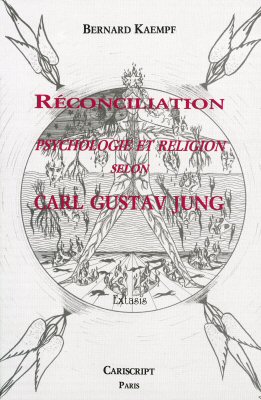Il est des rencontres essentielles qui surviennent au moment où l’on en a le plus besoin, sans qu’on les ait cherchées, et dont l’importance ne se révèle que dans le temps. Celle que j’ai faite avec Bernard Kaempf, le jour de ma difficile soutenance de thèse sur Jung, en fait partie. Il m’a apporté non seulement un soutien intellectuel mais aussi un vrai compagnonnage autour de la pensée jungienne. Ariane Callot
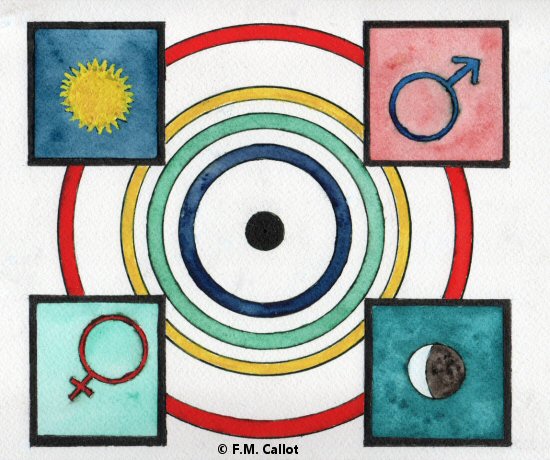
Bernard Kaempf, un envoyé de Jung !
Le jury, cinq personnes plus mon directeur de thèse, me fait face. Ils sont assis derrière une haute et longue estrade, le visage fermé.
Derrière moi, le public venu me soutenir ou assister à une curiosité dans le domaine de la philosophie : une thèse fondée sur la pensée de Jung. Ça chuchote…
Moi, j’ai droit à une petite table nue et à une chaise si inconfortable que, les heures passant, elle devient un instrument de torture.
Je me sens de plus en plus mal car j’ai l’impression de me trouver devant un tribunal de l’inquisition qui m’a condamnée d’avance au sujet d’écrits qu’il n’a même pas lus. Ils m’interrogent à tour de rôle mais le nom de Jung n’est jamais prononcé. On me parle plutôt du côté sulfureux de l’alchimie ou même de mes erreurs de ponctuation. Dans cette salle, des années de réflexion et de travail sont en train de disparaître…
Le sixième « juge » à droite, qui va parler le dernier, me fait particulièrement peur. Je sais juste par mon directeur de thèse qu’il a accepté de remplacer, au dernier moment, un professeur relativement célèbre qui aurait dû être la « vedette » de ce jury mais s’est désisté. Il vient de Strasbourg, c’est un pasteur théologien et il paraît qu’il s’intéresse à Jung. À part cela j’ignore tout de lui et sa mine de plus en plus sévère me terrifie.
Et puis, le miracle se produit.
Pour commencer, ce n’est pas à moi qu’il s’adresse mais aux autres membres du jury. Il leur dit qu’il en a assez d’entendre des « absurdités ». Que si il a pris la peine de lire 600 pages de thèse en quelques jours et de faire le voyage Strasbourg-Montpellier c’est parce que le travail présenté lui semblait particulièrement intéressant.
Il prend la soutenance en main, me pose les questions que j’attendais, me pousse avec bienveillance vers mes limites. Il sait aussi faire sourire le jury et j’ai l’impression que l’esprit puissant de Jung est venu me sauver du bûcher !
Et tout se finit bien avec la mention espérée.
L’ascenseur émotionnel
J’ai invité mon directeur de thèse, le jury, des membres de ma famille et quelques amis proches, à un buffet sur la plage à quelques kilomètres de Montpellier.
La bonne humeur règne, le rosé est bien frais, les inquisiteurs sont charmants et je me détends jusqu’au moment où Bernard Kaempf, profitant d’un moment où je suis seule, me propose de m’asseoir avec lui pour faire un peu mieux connaissance.
Je suis ravie, je réponds à quelques questions sur ce qui m’a amenée à ce travail, il renouvelle le bien qu’il en pense et c’est alors qu’il me dit d’une voix douce : « Savez -vous que j’ai écrit un livre sur Jung ? » Je me liquéfie… Je ne connais pas son livre… quel aspect de Jung aborde t-il… il n’est pas dans ma bibliographie… Les pensées et les interrogations se heurtent dans ma tête.
Et c’est encore cet homme d’une gentillesse rare qui, me voyant au bord du malaise, me dit qu’il ne m’en veut pas du tout, que cela a pu m’échapper, que c’était à mon directeur de thèse de me le signaler etc…
Le lendemain matin on sonne à ma porte. C’est Bernard Kaempf, un taxi l’attendant pour le conduire à la gare, qui vient m’apporter son livre gentiment dédicacé. Le titre est beau : RÉCONCILIATION Psychologie et Religion selon CARL GUSTAV JUNG.
Quelques jours après, il m’offre, avant le dépôt définitif du texte de ma thèse, de revoir entièrement ma bibliographie qui comprend de nombreuses fautes dans les titres des ouvrages en allemand. C’est une aide précieuse.
Une belle amitié
C’est ainsi que naquit une belle amitié autour de Jung ; amitié facilitée par le fait que j’habitais à quelques centaines de mètres de la faculté de théologie protestante où Bernard Kaempf se rendait assez souvent pour des conférences ou des soutenances.
Ses visites étaient à la fois celles d’un pasteur qui avait un merveilleux contact avec mon mari lourdement handicapé et celles d’un remarquable connaisseur de la pensée de Jung. Il possédait aussi un grand amour de la vie, y compris la bonne chère et le bon vin, le tout accompagné d’un humour décapant !
Il avait certainement des défauts mais je n’ai pas eu l’occasion de les discerner car même sa femme, que j’ai eu l’occasion de rencontrer, était charmante !
Cette relation si enrichissante a duré pendant les années que j’ai passées à Montpellier puis est devenue épistolaire quand je suis partie en Bretagne. Son décès, en 2008, m’a fait beaucoup de peine. La lourdeur des soins que demandait mon mari m’avait rendu difficile tout travail intellectuel et j’ai eu l’impression que sa mort m’éloignait encore un peu plus de Jung, comme si un pont était coupé.
Cependant, alors que des années ont passé, je n’ai rien oublié de son soutien et de nos échanges.
Dialogues avec Bernard Kaempf
Le pasteur Kaempf m’a aidée sur un plan pratique. Il m’a par exemple recommandé un jeune étudiant en théologie qui a logé chez nous pendant ses années d’études et j’ai ainsi pu avoir une aide précieuse pour mon mari. Il est aujourd’hui en poste dans une grande ville de France.
Bernard Kaempf, alors que j’étais très isolée intellectuellement, m’a permis de partager ma passion Jungienne. Je précise que, quand j’emploie ici le mot dialogue, c’est au sens philosophique de penser ensemble, de partager son savoir et ses questionnements.
Un enrichissement réciproque
Bernard Kaempf m’a transmis la connaissance de certains textes que je n’avais jamais pu lire. En effet, sa maîtrise parfaite de l’allemand lui donnait accès à des œuvres de Jung qui n’étaient pas, au début des années 2000, traduites en français. Pour ce qui est de moi, il disait que discuter avec une « laïque » plutôt qu’avec des théologiens, souvent très ignorants au sujet de Jung, était très « reposant ».
Nous avons beaucoup échangé autour du rêve et de son interprétation. Il s’intéressait à ma manière d’aborder le côté structurel des séries de rêves et j’ai appris à son contact ce que la « cure d’âme » des pasteurs pouvait apporter à un être en souffrance.
Réconciliation
Réconciliation avec soi-même
Le thème central du livre de Bernard Kaempf, la réconciliation, a été dominant dans nos dialogues. Il avait choisi, ce qui est normal pour un pasteur, de privilégier la réconciliation avec soi-même et avec la religion, au sens vaste et jungien de ce mot.
Pour ce qui est de la réconciliation avec soi-même, il a su me valoriser et me donner une confiance en moi qui me manquait cruellement. Il m’a aussi montré que tous les moments de la vie sont importants et que le fait que j’ai tant tardé à concrétiser dans une thèse mes recherches sur Jung avait un sens ; pour lui, c’était le moment et mon âge importait peu.
Bernard Kaempf et les théologiens
Cela s’était vu au moment de ma soutenance de thèse, Bernard Kaempf savait aussi s’indigner. Par exemple, en tant que théologien, il jugeait avec sévérité le comportement de ses confrères vis-à-vis de la pensée de Jung.
Il écrit dans l’introduction à son livre (p.11) que « si Jung a toujours été très attentif à la réaction des théologiens face à son œuvre » la réaction de ceux-ci s’est le plus souvent résumée en trois mots : « scepticisme, critique ou mépris pur et simple. » Il était aussi irrité par le fait que la psychologie jungienne ait été éclipsée par celle de Freud.
Le fait qu’il ait été pasteur de paroisse, un homme pragmatique qui fait le lien entre l’humain et le religieux, explique qu’il ait voulu « réconcilier » la pensée de Jung avec celle des théologiens. Il ne se contentait pas de protester, il agissait en effectuant de nombreuses recherches dans l’œuvre de Jung et en la faisant connaître grâce à l’écriture.
Réconciliation avec la religion
Issue d’une famille qui comprenait à la fois des catholiques et des protestants, j’avais rompu avec toutes mes racines religieuses. J’affichais même un certain mépris, certainement inspiré par mon ombre, envers ce que j’appelais les bondieuseries. Ceci était d’autant plus étrange que j’étais très attirée par certaines formes de « spiritualité ».
Bernard Kaempf, avec l’aide de Jung, m’a doucement mise en face de mes contradictions.
Comment pouvais-je être jungienne et être ainsi fâchée avec la religion alors que Jung accorde tant d’importance à l’attitude religieuse de l’homme ? L’image de Dieu est inscrite en nous et une bonne partie de ma thèse, disait-il, reposait sur cette affirmation.
Il m’a montré le chemin que Jung avait parcouru : d’une image suspecte du Seigneur Jésus dans son enfance à une relation possible entre le Soi et Christ. Il m’a fait aussi comprendre l’importance que Jung accordait au secours que la religion pouvait apporter à ceux qui risquaient d’être submergés par leur inconscient.
Avec un esprit toujours ouvert à mes contradictions, et disposé a entendre évoquer les siennes, Bernard Kaempf m’a fait voir qu’une attitude unilatérale envers la religion, probablement issue de mon enfance, n’était pas constructive.
Je ne dirais pas que je suis devenue pratiquante mais, intérieurement, j’ai été profondément influencée par nos dialogues sur la religion.
Conclusion : un dialogue intemporel
Les années ont passé et pourtant, aujourd’hui encore, je mesure l’apport de cette rencontre avec Bernard Kaempf.
Soutien précieux dans un moment de grande vulnérabilité, il m’a permis, au fil de nos rencontres, d’ancrer dans le réel une pensée jungienne moins intellectuelle.
À travers nos échanges, j’ai pu me réconcilier avec moi-même, avec mon parcours et, dans une certaine mesure, avec mes racines religieuses. Ce chemin, je ne l’aurais sans doute pas parcouru seule. Pour m’accompagner, il fallait un homme comme lui, alliant l’exigence du chercheur à la chaleur humaine.
Je me laisse aller à rêver d’une rencontre entre Jung et Bernard Kaempf. Ils auraient sans doute débattu avec passion et respect réciproque et certainement trouvé un terrain d’entente.
Ce dialogue n’a jamais eu lieu mais, dans l’amitié que j’ai partagée avec Bernard Kaempf, quelque chose de ce moment manqué a pu exister.
Mai 2025
En lien avec cet article :
Lire également Les dédoublements du thésard d’Ariane Callot et la Discussion avec Rachel Huber et Jean-François Alizon sur Opicino de Canistris.
Bernard Kaempf
Après ses études d’allemand et de théologie à Strasbourg, Montpellier et Tübingen, Bernard Kaempf (1943-2008) a été Pasteur de paroisse pendant près de dix ans.
Son intérêt pour D.F. Schleirmarcher, Albert Schweitzer et C. G. Jung s’est concrétisé dans la publication d’une série d’articles et de traductions.
Sa thèse de doctorat en théologie, préparée à Strasbourg, Zurich et Princeton, portait sur Jung et la théologie pastorale.
Il a été professeur de théologie pratique à la Faculté de Théologie Protestante de Strasbourg, où il s’est spécialisé dans les questions d’accompagnement pastoral et de cure d’âme.
Adresser un message à Ariane Callot
Articles Ariane Callot
- Individuation et individualisme
- C.G. Jung et la géomancie
- Sur l’utilisation des citations de Carl Gustav Jung
- Prologues aux représentations théâtrales d’une série de rêves
- Quand la psyché est un champ de bataille
- C.G. Jung et l’Horloge du Monde
- Carl Gustav Jung et l’œuvre de Frank Herbert
- Wolfgang Pauli, Carl Gustav Jung et la femme inconnue
- L’inspiration alchimique de Jung dans trois œuvres essentielles
- Comment aborder le livre de C.G. Jung Psychologie et Alchimie ?
- Carl Gustav Jung et l’arbre philosophique
- Réponse à Job : Jung et ses détracteurs
- Les termes alchimiques éclairés par Dom Pernety et C.G. Jung
- Les dédoublements du thésard
- Rencontres autour de Jung avec Bernard Kaempf
- Jung, Rimbaud, vers l’alchimie poétique
- Carl Gustav Jung, Gérard de Nerval et Aurélia
- Jung / Nietzsche : Dieu ne peut pas mourir
- Jung / Nietzsche : le côté positif/négatif de la maladie
- Jung / Nietzsche, rendez-vous et évitement
Articles co-écrits avec Jean-Pierre Robert :
- La psychologie de Carl Gustav Jung expliquée clairement
- Carl Gustav Jung et Junichirô Tanizaki font l’éloge de l’ombre
Trois rubriques complètent cette liste d’articles :