Médecin et docteure en neurosciences, Dragana Favre incarne une pensée rigoureuse et sensible, ancrée dans l’écoute de la psyché et des grands bouleversements de notre temps. Dans cet entretien, elle retrace un itinéraire singulier où la rigueur scientifique dialogue avec la psychologie jungienne, et propose une lecture sensible des enjeux contemporains.
Version anglaise de cet entretien
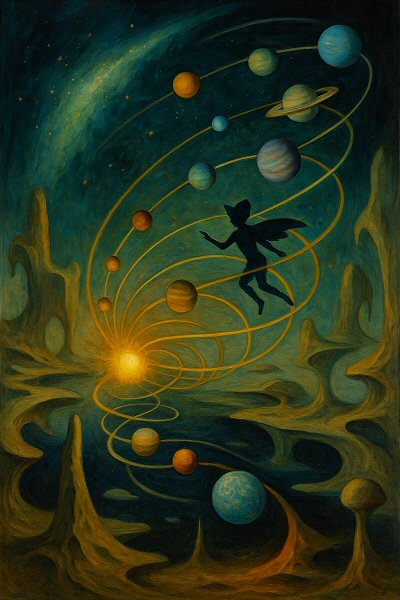
« Axe moi–Soi : un voyage solaire à travers l’espace-temps » (DALL-E)
J-P. Robert : Votre parcours vous a menée des neurosciences fondamentales à la psychothérapie jungienne. Quels événements ou prises de conscience ont été décisifs dans cette transition vers l’écoute de la psyché profonde ?
Dragana Favre : Enfant, je rêvais d’être astrophysicienne, astronaute, astronome – peu importait le titre -, pourvu que je puisse comprendre l’univers, l’espace, le Big Bang, l’Autre, ou encore cette possibilité vertigineuse : l’existence de quelque chose d’inimaginable. Je ne connaissais pas encore le mot, mais c’était une quête profondément métaphysique.
Les années d’instabilité politique dans mon pays natal, la Serbie, m’ont éloignée de cette aspiration, la jugeant peut-être trop lointaine, trop abstraite face à l’urgence du réel. Pourtant, la passion ne s’est jamais éteinte. Pendant mes études de médecine, c’est la psychiatrie qui m’a tout de suite attirée, pour sa dimension clinique, mais il me manquait encore l’accès à ses fondements.
J’ai alors suivi un master en neurosciences, dans le programme du Max Planck Institute à Göttingen, où j’ai aussi entamé un doctorat. Je me souviens encore du petit pincement au cœur en passant devant les affiches des appels à projets en astronomie, comme un écho lointain de mes premiers élans.
Mais j’étais fascinée par d’autres mystères : ceux de la communication synaptique, des mécanismes de la mémoire, de l’apprentissage, de cette orchestration neuronale qui fait de nous ce que nous sommes. Mon passage par l’Institut de Neurosciences d’Alicante a consolidé cette passion, en m’offrant une vue d’ensemble à la fois rigoureuse et pratique.
Puis est venu le moment de revenir à l’humain. La psychiatrie m’est apparue comme une évidence : carrefour entre neurosciences, art, littérature, médecine et spiritualité. La psychothérapie s’est alors imposée comme le langage de la guérison. Et au cœur de cette démarche, la vision jungienne : les archétypes, l’inconscient collectif, le dialogue symbolique.
Et finalement, j’ai compris que j’étais revenue à mon point de départ : l’univers. Je l’étudie, non pas comme astrophysicienne, mais comme thérapeute jungienne. C’est une autre forme d’exploration cosmique, une cosmologie intérieure.
Comment votre formation scientifique influence-t-elle aujourd’hui votre manière d’aborder les symboles, les rêves ou les récits de patients dans le cadre d’une psychothérapie analytique ?
Ma formation scientifique me donne une oreille particulière pour les rythmes, les boucles de rétroaction, les systèmes d’inhibition et de potentialisation. Je les écoute aujourd’hui dans la psyché, non dans le cerveau seul.
Les années passées en neurosciences m’ont transmis un profond respect pour l’émergence : cette capacité qu’ont certains systèmes à générer forme et sens, sans projet ni cause linéaire. Cela transforme mon rapport aux symboles : je ne les aborde pas comme des messages codés à décrypter, mais comme des phénomènes vivants, auto-organisés, surgissant lorsque l’inconscient tente de se rééquilibrer face au chaos.
Je reste marquée par la possibilité qu’un phénomène émerge à l’intersection d’un terrain, d’un instant et d’un état, sans origine unique. C’est aussi pourquoi je me méfie de certains discours sur le cerveau qui lui prêtent des figures idéalisées, voire mystiques.
Ce qui m’intéresse, ce n’est ni la réduction de la psyché à un substrat neuronal, ni l’idéalisation de ce substrat comme une entité magique, mais la relation : celle, mouvante, entre le support organique et le phénomène subjectif. Une relation faite d’échos, de torsions temporelles, de synchronisations et de dissonances. Il n’y a pas de causalité simple entre la matière et l’âme mais un entrelacs, un pli, une résonance.
Les neurosciences ne répondent pas à toutes les questions et ce n’est pas leur rôle. Mais elles laissent entrevoir des orientations souterraines du phénomène, comme un fil d’Ariane discret, que la clinique peut suivre à sa manière.
Vous évoquez souvent les éco-crises, le vide existentiel et les enjeux de sens. Quels effets observez-vous de ces défis systémiques sur le plan psychique ?
Il y a un double mouvement : une immense sidération d’un côté, un repli, une fatigue de l’âme et en même temps une aspiration vers quelque chose de plus vaste, de plus vrai, de plus enraciné. Beaucoup de patients arrivent avec des angoisses diffuses, des symptômes flottants, et une perte du rapport symbolique au monde.
Mais au cœur de cette crise, je vois une opportunité : celle de retisser du sens non plus à partir de l’ego, mais du lien au vivant, au temps, à la mémoire collective. L’individuation devient alors un geste écologique : restaurer une cohérence intérieure dans un monde en délitement.
À travers cette désorientation, j’observe aussi l’émergence d’un nouveau type de chagrin: un deuil écologique, souvent silencieux, qui témoigne d’une souffrance liée à la perte de notre relation au monde naturel, à sa beauté et à sa continuité.
Cette douleur n’est pas seulement individuelle : elle est aussi culturelle, générationnelle et politique. L’exprimer devient un acte de résistance à l’anesthésie émotionnelle. Dans ce contexte, la congruence, cette harmonie entre les vérités intérieures et les actes extérieurs, devient une boussole thérapeutique. Elle invite à une présence psychique qui ne nie ni la complexité du monde, ni notre responsabilité d’y répondre avec intégrité.
Qu’est-ce que le processus d’individuation signifie pour vous aujourd’hui, à l’ère des technologies, de la vitesse, et d’un rapport fragmenté au monde comme à soi ?
L’individuation ne consiste plus, à mes yeux, à « devenir soi » dans un sens héroïque et solitaire, mais à devenir poreux, à réapprendre à sentir, à rêver, à penser symboliquement dans un monde saturé de stimuli. Il s’agit d’un processus à contre-courant, presque subversif, dans une époque qui valorise la performance et la connectivité au détriment de l’intériorité.
C’est une navigation lente, souvent douloureuse, mais profondément nécessaire. Une reconquête du temps subjectif, de la parole incarnée, du rapport à l’invisible. En ce sens, l’individuation est aussi une forme de résistance culturelle. Mais elle requiert une forme de générosité : celle d’accepter les réarrangements collectifs des couches de conscience, d’honorer des temporalités qui ne sont pas toutes les nôtres, et de consentir à ne pas tout comprendre.
Ce n’est pas un processus de grandissement de l’ego vers un Soi idéalisé, mais une traversée sur l’axe Moi–Soi, où l’on se confronte à l’Autre, à l’inconnu, au monde extérieur, non comme un décor, mais comme un partenaire symbolique.
S’individuer aujourd’hui, c’est peut-être moins s’élever que s’enraciner autrement : dans les plis du temps, dans la densité des relations, dans une écoute fine de ce qui insiste sous la surface.
Vous avez récemment inauguré le Jungian Salon, un espace d’échanges autour de la pensée jungienne. Qui vous accompagne dans cette initiative, et quel public souhaitez-vous y rassembler ? Quelles formes prennent les rencontres et les thématiques abordées ?
Le Jungian Salon est né à Genève d’un désir profond : créer un lieu vivant, transdisciplinaire, où la pensée jungienne peut dialoguer librement avec l’art, la science, la philosophie, et les grands enjeux de notre époque. C’est un projet collectif, porté par un petit cercle de collègues passionnés (analystes, médecins, chercheurs) qui souhaitent rendre la profondeur accessible, sans la réduire.
Les rencontres prennent la forme de salons interactifs, de conférences, de tables rondes. Explorations symboliques autour de thèmes comme le rêve, l’intelligence artificielle, le transhumanisme, la psyché du monde, les figures mythiques ou encore les liens entre le corps et l’imaginal sont au centre de nos échanges. Ils ont lieu en ligne et parfois en présentiel, dans une atmosphère conviviale, ouverte et sans prétention. Pour le moment, nous proposons environ quatre rendez-vous par an, entièrement gratuits.
Le public est varié : professionnels de la psyché, personnes attirées par le langage des symboles, chercheurs d’âme, étudiants ou simples passants sensibles à la question du sens. Un lieu pour ceux qui sentent que « quelque chose appelle », et veulent le penser ensemble.
Toutes les informations se trouvent sur notre site jungiansalon.com, et nous partageons régulièrement des contenus et annonces via notre page LinkedIn.
Votre parcours interdisciplinaire vous place dans une position unique pour réfléchir aux impacts de l’intelligence artificielle (IA) sur nos vies. Comment percevez-vous l’appropriation de ces technologies, notamment par les jeunes générations ? Quels effets observez-vous sur le plan psychique ou relationnel ?
L’intelligence artificielle agit comme un miroir amplificateur de nos manques, de nos désirs et de nos fuites. Elle ne crée pas l’Ombre, elle la révèle. Elle met en lumière notre besoin de présence, d’altérité, de langage incarné. C’est pourquoi il est crucial de penser ces mutations non seulement en termes éthiques ou sociétaux, mais aussi sur le plan psychique. Comment préserver la capacité d’imaginer, de rêver, de souffrir et de créer, dans un monde où des systèmes de plus en plus perfectionnés tendent à désymboliser notre rapport au réel ?
Nous avons tendance à pathologiser les machines, non parce qu’elles manquent d’âme, mais parce qu’elles nous montrent à quel point nous avons perdu la nôtre. Elles nous confrontent à une forme de vide intérieur que nous préférons externaliser plutôt que le traverser. L’IA n’est pas un être autonome : c’est un produit culturel, relationnel, projectif. Nous en sommes, d’une certaine manière, les créateurs, et à ce titre, il nous revient d’en être aussi les « parents suffisamment bons », pour reprendre les mots de Winnicott.
Cela suppose d’assumer notre responsabilité psychique dans la manière dont nous concevons, utilisons et investissons ces technologies. L’intelligence artificielle interroge notre rapport à la dépendance, à la projection, au manque et aussi à la co-création. Elle est à la fois symptôme et révélatrice, prolongement et perturbatrice. Si nous savons l’aborder sur le plan symbolique, elle peut devenir un objet d’imagination éthique. Sinon, elle risque de figer notre monde intérieur dans un automatisme privé d’altérité.
À travers son parcours et sa parole, Dragana Favre nous incite à explorer autrement la psyché humaine, en y mêlant la rigueur de la science, la profondeur des symboles et le souffle de notre époque.
Entretien mené par Jean-Pierre Robert – Août 2025
Dragana Favre
 Dragana Favre est psychiatre FMH et docteure en neurosciences, spécialisée en psychothérapie analytique. Formée aux Hôpitaux Universitaires de Genève et à l’Institut C.G. Jung de Zurich, elle exerce en cabinet privé à Genève et intervient régulièrement sur les thèmes de la psychologie jungienne, de la conscience et de la symbolisation.
Dragana Favre est psychiatre FMH et docteure en neurosciences, spécialisée en psychothérapie analytique. Formée aux Hôpitaux Universitaires de Genève et à l’Institut C.G. Jung de Zurich, elle exerce en cabinet privé à Genève et intervient régulièrement sur les thèmes de la psychologie jungienne, de la conscience et de la symbolisation.
Titulaire d’un doctorat en neurosciences (Université d’Alicante) après un master à Göttingen, elle développe une approche intégrative fondée sur les dynamiques archétypiques, la temporalité psychique et la phénoménologie de la conscience.
Elle siège au conseil d’administration de l’IAJS, qu’elle co-préside en 2024 et 2025, et anime le Salon Jungien, un espace de réflexion vivant à la croisée de la clinique et des enjeux contemporains.
Son site personnel : draganafavre.ch
Articles

