Dialoguer avec votre inconscient est possible car l’imagination active offre un chemin puissant vers la connaissance de soi. Inspirée par l’œuvre de Carl Gustav Jung, elle vous ouvre à un dialogue vivant avec les images de l’inconscient : découvrez-en les clés dans notre entretien avec Jean-François Alizon. J-P. Robert
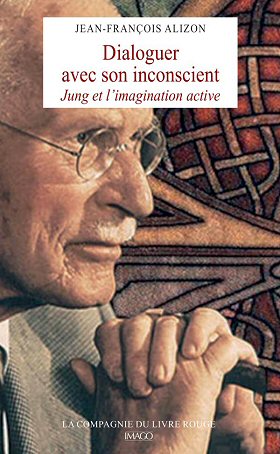
Cet entretien se concentre sur quelques questions essentielles autour du dialogue avec l’inconscient. L’ouvrage de Jean-François Alizon va bien au-delà : il explore d’autres aspects fondamentaux et offre surtout un exemple remarquable d’imagination active, qui en illustre toute la richesse et la profondeur.
J-P. Robert : Vous abordez un thème essentiel : le dialogue avec l’inconscient. Pour commencer, que signifie au juste « dialoguer avec son inconscient » ?
Jean-François Alizon Peut-être avez-vous fait cette expérience : sentir au fond de soi que quelque chose s’oppose à nos projets, à nos amours, et à tout ce qui fait nos engagements dans la vie. On peut repousser ce quelque chose, et détourner la tête pour l’oublier et s’investir à fond dans les activités. Ou bien se laisser envahir, déprimer, et se désintéresser de tout.
Jung nous propose une alternative : essayer de comprendre ce qui veut se dire en nous, en passant par l’établissement d’une véritable relation émotionnelle avec ce qui se révèle être, à l’usage, un véritable interlocuteur intérieur. Cette relation peut se réaliser de multiples façons : la plus efficace passe par une mise en mots, en établissant une négociation avec l’autre en nous. Si celle-ci est bien menée, sans que le moi perde le contrôle, elle peut nous permettre de prendre conscience d’aspects inconnus de notre personnalité et de trouver le sens profond de notre destinée.
Le Livre rouge de Carl Gustav Jung est un précieux témoignage d’une imagination active qui l’a mené à une série de découvertes à l’origine de la psychologie qui porte son nom. En quoi ce livre vous a-t-il inspiré, et quel rôle joue-t-il dans votre propre travail ?
Jung a nommé cette expérience « imagination active » Il l’a découverte dans les années 1913-1916. Freud avait été jusque-là pour lui une figure paternelle importante. La rupture entre eux le plonge dans la dépression. Mais au lieu de se laisser abattre, il tente l’expérience de laisser parler « l’esprit des profondeurs » sa voix intérieure, et de le confronter avec « l’esprit du temps », sa persona.
La puissance des énergies en présence ouvre un chantier éprouvant, qui le mène au bord de la folie. Mais elle ramène à la surface des figures nouvelles qui lui permettent de reconstruire sa personnalité véritable, et de fonder son œuvre ultérieure sur la force de l’expérience. Nombre des scènes qu’il raconte sont de très beaux exemples de confrontation entre l’opposition rageuse du moi de Jung à une volonté autre en lui, qui débouchent à chaque fois sur la création d’une nouvelle forme de vie.
Chaque scène est suivie du commentaire analytique de Jung redevenu psychiatre. Ce livre a une puissance pédagogique très utile à qui veut bien entrer en profondeur dans les forces en présence. J’ai animé un groupe de lecture à Strasbourg, où pendant 8 ans nous avons labouré ce texte aux ouvertures infinies. Il nous a tous nourri d’images essentielles. On peut dire que l’imagination active est au centre de la démarche jungienne, elle la fonde.
Pourquoi avoir choisi d’ouvrir votre livre par un chapitre intitulé Revaloriser l’imagination ?
Dans notre culture occidentale, l’époque classique a été un moment important où les sciences se sont dégagées de la pensée symbolique. L’alchimie est devenue chimie. L’imagination qui donnait du sens aux évènements symboliques est devenue alors « la folle du logis » qui obscurcissait les processus rationnels de la connaissance.
On retrouve ce processus dans la démarche freudienne, où elle n’est que fantasme issu du « ça ». Lui donner un autre statut est déraison. Pour nos contemporains, elle est la plupart du temps valorisée dans le domaine de l’art, et de la littérature, mais s’en remettre à elle pour la conduite de l’âme est folie.
Or dans certaines traditions spirituelles anciennes, on faisait la distinction entre une imagination errante « fantastique », et une autre qui rapprochait de la divinité et de l’essence des choses, l’imagination vraie. Paul Ricoeur avait repris ce thème en montrant que les mythes avaient accès à une vérité de l’âme que la raison ne pouvait atteindre. Et pour Jung, l’imagination vraie est un très bel outil de rééquilibrage de la psyché.
Vous insistez sur l’importance de ne pas confondre l’imagination vraie et l’imagination fantastique. Pouvez-vous expliquer cette distinction, et pourquoi elle est si essentielle à vos yeux ?
Cette distinction est essentielle pour comprendre le processus à l’œuvre dans l’imagination active. Si ce qui remonte de l’inconscient n’est que folie, il faut vite remettre le couvercle. Si nous avons accès à une instance intérieure qui a du sens, alors nous avons tout intérêt à connaître ce qui veut se dire.
On voit d’abord que l’attitude du moi est essentielle dans cette distinction : s’il est faible, il se laisse emporter par les images et il entre dans l’errance. S’il est assez avisé, ou s’il est bien accompagné pour distinguer dans ce qui monte de l’inconscient ce qui a du sens et ce qui n’en a pas, et s’il peut être dans l’attitude de négociation, alors il peut recueillir quelque chose de vital.
Le second point est la distinction entre l’inconscient personnel et l’inconscient collectif. Si ce qui remonte est le produit de l’introjection de jugements négatifs qui détruisent la personnalité par un travail de sape, il faut apprendre à dire non et à combattre. Mais si des images fortes et nouvelles apparaissent, il y a des chances pour qu’elles proviennent de l’inconscient collectif et qu’elles apportent des impulsions vitales à la psyché.
C’est pour moi la bonne nouvelle découverte par Jung : nous gardons en nous intactes les instances créatrices et positives qui fondent la possibilité d’une vie forte et équilibrée. Lorsque les images issues de ces instances remontent, elles permettent un rééquilibrage de la vie psychique. L’imagination est vraie lorsqu’elle nous met en relation avec elles, en créant une sorte d’espace transitionnel où la psyché peut se reconstruire.
L’école d’Avicenne, au XIe siècle, avait postulé l’existence d’un espace intermédiaire entre la terre et le ciel, où nous pouvons entrer en relation avec les âmes et la divinité par l’intermédiaire de l’imagination vraie. On pourra trouver dans le chapitre dédié de mon ouvrage d’autres éclairages sur cette question importante.
Les difficultés sont nombreuses lorsqu’on tente de dialoguer avec son inconscient. Quelles sont, selon vous, les principales embûches rencontrées sur ce chemin ?
Chaque étape d’une séance d’imagination active peut générer des difficultés. On peut en distinguer quatre :
La première étape consiste à s’isoler du monde extérieur pour entrer en soi, et laisser advenir une image intérieure. Pour un individu extraverti, c’est une étape presque impossible. La capacité à entrer assez loin en soi et à s’ouvrir à une scène intérieure est variable selon les personnes, elle demande un entraînement.
Dans la deuxième étape, le moi doit se placer dans la scène, et se mettre en relation avec les éléments apparus, objets, animaux, personnages. Pour cela il lui faut accepter leur présence et leur nature, accepter qu’ils représentent une partie de soi inconnue ou réprimée. Il est essentiel de prendre au sérieux leur présence et leur réalité. Comme dans toute expérience analytique, le sujet résiste et refuse de les accepter, ou ressent comme une défaite humiliante d’avoir à le faire. Il dénie qu’ils soient une partie de son inconscient er affirme qu’ils ne sont que de vagues fantasmes sans intérêt. Il peut aussi enlever toute dimension affective et émotionnelle aux contenus, et les réduire à une compréhension intellectuelle pour neutraliser leur impact.
La troisième étape consiste à comprendre ce que l’autre côté veut dire, et établir une négociation avec le contenu pour évaluer ce que l’on peut en intégrer dans la vie consciente. Les étapes de cette confrontation ne sont d’habitude pas décrites dans la littérature. Je détaille dans mon livre quatre moments, qui passent de la négociation à des expériences initiatiques très intenses.
Mais il faut d’abord, pour réussir cette étape, comprendre le sens des images : que veut dire cet éléphant qui apparaît soudain dans la scène intérieure de cet homme ? De fait, il représente la puissance de sa mère, qui l’écrase. Il lui faudra l’affronter.
Le langage de l’inconscient, comme on le sait par le travail avec les rêves, est complexe, mais la discussion intérieure avec le contenu permet le plus souvent de saisir le sens de la scène. Encore faut-il que le moi trouve en lui-même l’énergie pour parlementer et se poser face à l’autre sans se laisser écraser. Et qu’il trouve le moyen de parler et d’écouter ce qui lui revient. Le temps et la pratique permettent de vaincre peu à peu ces difficultés.
Il faut aussi mentionner la puissance des opinions négatives sur soi-même introjectées dès l’enfance, qui minent le moi et essaient de dévaloriser complètement l’imagination active. Elles reviennent à la charge avec des déguisements différents, donc le moi doit apprendre à les reconnaître et les démonter à chaque fois.
Enfin, la quatrième étape consiste à décider d’intégrer dans la vie quotidienne les modifications qui ont été négociées, puis à avoir le courage de le faire. Dans l’exemple indiqué, savoir faire face à la mère réelle comme à l’éléphant dans la scène. Le moi peut se dérober à cet effort, et considérer que tout cela n’est que simple fantasme et refuser les implications éthiques de la rencontre.
On peut mesurer à la lecture du livre rouge combien difficile a été pour Jung l’intégration de son travail intérieur. En général, le moi sort de cette épreuve très renforcé. Mais l’expérience lui est très difficile au début s’il n’est pas suffisamment fort et s’il n’a pas assez confiance en lui.
Y a-t-il des dangers à se lancer seul dans une pratique d’imagination active ? Faut-il être accompagné ?
Jung conseillait à ses patients de pratiquer l’imagination active en fin de traitement, pour acquérir leur autonomie par rapport à l’analyste et continuer, une fois la cure terminée, à vivre en relation avec l’inconscient. L’expérience analytique est indispensable pour se connaître et savoir discerner ses complexes dans les scènes intérieures. Elle seule peut donner les outils nécessaires à la confrontation avec l’inconscient toujours vivant.
Jung a pu mener sa recherche seul car il était un psychiatre au contact avec l’inconscient de ses patients du Burghölzli, et aussi grâce à son côté intuitif introverti. Se lancer seul dans l’imagination active sans parcours analytique préalable expose au risque de psychose. On peut avoir une structure névrotique, ou une structure psychotique sans en être malade.
La première développe une barrière puissante contre l’inconscient pour se protéger contre une angoisse sous-jacente très forte. Si cette barrière tient bon, aucun travail en imagination active ne sera possible. Mais si elle s’écroule, le moi risque de perdre ses repères.
Et la seconde aura une grande facilité, mais le moi est faible, et en danger permanent d’être envahi par les remontées de l’inconscient et de décompenser. La pratique de l’imagination active est de toutes façons à déconseiller formellement dans toutes les pathologies où le moi est inconsistant et sans conscience des limites.
Il est beaucoup plus sûr de pratiquer l’imagination active avec un thérapeute. Il la rend aussi beaucoup plus efficace : d’une part, les difficultés évoquées plus haut se trouvent aplanies. La scène peut être reprise et explorée après coup comme après un rêve, ce qui renforce l’importance émotionnelle de ce qui s’est passé.
Le thérapeute peut aussi souligner les faiblesses éventuelles du moi, et l’importance de trouver en soi-même la capacité de confrontation. Sa présence donne au sujet confiance en lui-même, cette confiance qui lui manque souvent dans la vie courante. D’autre part, la dimension transférentielle augmente considérablement l’impact de la scène, car la confiance dans un référent extérieur ajoute une qualité de réalité et de vérité à ce qui se passe. Elle donne au sujet une capacité de naître à soi-même, par la puissance des rencontres avec les images intérieures. Tout ceci est développé dans mon livre.
Vous comparez différentes méthodes et montrez en quoi elles s’écartent de l’imagination active telle qu’elle devrait être pratiquée. Pourriez-vous préciser ce qui, selon vous, distingue véritablement l’imagination active des autres approches
C’est une question très délicate, car il existe de nombreuses méthodes de renaissance à soi, et surtout de nombreux thérapeutes. Ils occupent la place centrale et réinventent leur méthode selon les patients. Ils peuvent être amenés à pratiquer à leur manière l’imagination active sous forme d’hypnoses ou de jeux de sable.
J’ai essayé dans mon ouvrage de définir 7 critères de comparaison, mais toujours en modérant mon propos. Je dirais, en accord avec Barbara Hannah et Marie Louise von Franz, que l’essentiel est dans le mot « active ». La méthode pousse le moi à être fort et actif dans la relation avec l’inconscient, à être un interlocuteur adulte, fort et engagé, tout en restant ouvert à la transformation. C’est au moi de se prendre en charge et de trouver en lui-même sa ressource. Le thérapeute, s’il est présent, n’intervient pas au cours de la scène, mais après, contrairement à d’autres méthodes.
Votre ouvrage est très complet et propose une synthèse qui en fait une véritable référence. Il donne envie de passer à la pratique… Par où commencer quand on souhaite s’engager soi-même dans le dialogue avec son inconscient ?
J’insiste bien : l’imagination active n’est pas un jeu, elle comporte une prise de risque. Elle engage la totalité de la personne, elle demande un effort soutenu, elle a un fort impact émotionnel, et peut entraîner des remises en question importantes.
Si l’on décide de tenter l’aventure avec un passé analytique, il est important de lire au préalable la littérature de Jung et de ses disciples sur la question, ainsi que mon chapitre sur les difficultés qu’on peut rencontrer dans la pratique. J’en donne une bibliographie à la fin de mon ouvrage.
Pour ceux qui n’auraient pas d’expérience analytique, commencer par travailler sur les rêves avec un professionnel pendant un temps assez long est une bonne entrée en matière. Au bout d’un certain temps, on peut se sentir prêt à descendre, comme Ulysse, dans le monde souterrain.
Apprivoiser les 4 étapes par essais successifs, seul ou en présence d’un thérapeute, sera naturel pour les uns, très difficile et angoissant pour les autres. Cela demande du temps et de la persévérance, mais le trésor qu’on peut trouver au bout du chemin est d’une valeur incommensurable.
Si ces mots éveillent en vous un écho, laissez-vous guider et entamez ce chemin intérieur, avec la prudence et la confiance qu’exige toute rencontre avec soi.
Entretien mené par Jean-Pierre Robert – Juillet 2025
Éditeur : La Compagnie du Livre Rouge & Imago – 2025 – 324 pages – ISBN 9782380891393 – 14 x 22,7 x 2,6 cm
 Jean-François Alizon
Jean-François Alizon
Jean-François Alizon est titulaire d’une maîtrise en théologie protestante de l’Université de Strasbourg, avec un mémoire de théologie de l’Ancien Testament. Puis, après des études musicales à Strasbourg et à Bâle, il est nommé en 1975 professeur de flûte au Conservatoire de Strasbourg et mène une carrière de concertiste.
Parallèlement et en résonance avec sa réflexion théologique, il étudie l’œuvre de Carl Gustav Jung de façon approfondie dès les années 1980. Il a été président de 2012 à 2015 de l’association jungienne de Strasbourg.
Il donne de nombreuses conférences, et anime des groupes de lectures de l’œuvre de Jung, qu’il éclaire de son expérience personnelle et de son chemin intérieur. Il est l’auteur d’un livre de pédagogie musicale.
Sur ce site :
- Entretien à propos du cas Opicino
- Entretien à l’occasion de la sortie du livre Jung et le christianisme
- Entretien à l’occasion de la sortie du livre Dialoguer avec son inconscient

