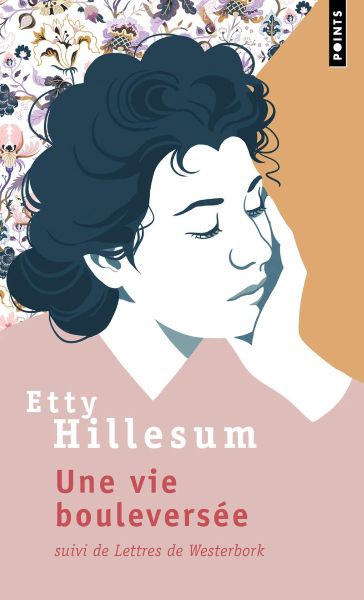Etty Hillesum (1914–1943), jeune femme juive néerlandaise, nous a laissé une œuvre d’une rare intensité qui, à travers l’épreuve, révèle un chemin d’individuation que la pensée de Carl Gustav Jung permet d’éclairer.
Dans Une vie bouleversée, son journal tenu de 1941 à 1943, suivi des Lettres de Westerbork, elle relate ce qu’elle vit, traçant ainsi son évolution intérieure. Ce récit, bien au-delà du témoignage historique bouleversant qu’il constitue, peut être lu comme une quête de conscience et de liberté intérieure.
Une voix plurielle vers le « Je »
Dès les premières pages du journal, le style d’Etty Hillesum trahit un chaos intérieur. Elle alterne les pronoms personnels : « je », « tu », « elle » – comme si plusieurs parts d’elle-même se disputaient la parole. Elle parle d’elle à la troisième personne lorsqu’elle se rejette, se critique avec une grande dureté. Le « tu » semble être l’instance critique, grondant cette autre Etty qu’elle ne parvient pas à aimer.
Mais peu à peu, cette pluralité conflictuelle laisse place à une unification intérieure. Le « je » devient central, et le « tu » s’adresse alors non plus à une part d’elle-même, mais à Dieu, ce Dieu qu’elle découvre en elle, personnel et empreint de différentes traditions religieuses. Ce glissement du regard marque la reconnaissance d’une dimension intérieure transpersonnelle, source d’unification et de sens.
Une psychanalyse existentielle
Avant la guerre, Etty est une jeune femme cultivée, polyglotte, passionnée de littérature russe, mais aussi tourmentée et dépressive. Elle entame une thérapie avec Julius Spier, chirologue, psychanalyste jungien, réfugié juif allemand à Amsterdam. Cette rencontre est décisive. Le lien est profond : thérapeutique, spirituel, amoureux. Le transfert est puissant, porteur de transformation.
C’est auprès de lui qu’elle amorce cette descente en elle-même, qu’elle apprend à « faire silence », à écouter sa voix intérieure, à prier, à s’abandonner sans se fuir. La démarche d’Etty est à la fois analytique et mystique. Elle note :
« Je sentais que ce rêve était un morceau de ma personnalité : il m’appartenait, j’y avais droit, je ne devais le connaître si je voulais sentir ma personnalité complète. » (p. 86)
Le rêve est considéré comme une clef pour entrer en dialogue avec soi-même : il n’est pas décoratif, il est fragment du Soi.
Aguerrie, jamais endurcie
À mesure que la persécution s’intensifie, Etty développe une posture intérieure d’une maturité bouleversante. Elle fait la distinction entre l’endurcissement – qui ferme le cœur – et l’aguerrissement – qui affine la lucidité sans perdre l’humanité.
« Je m’aguerris, mais je ne m’endurcirai probablement jamais. » (p. 197)
Cette position intérieure est d’autant plus remarquable que l’horreur croît inexorablement autour d’elle. Mais elle ne voile pas son regard. Elle voit et reste présente, sans haine, consciente qu’elle doit être témoin et qu’elle doit relater les faits :
« La sensation très nette qu’en dépit de toutes les souffrances infligées et de toutes les injustices commises, je ne parviens pas à haïr les hommes. Et que toutes les atrocités perpétrées ne constituent pas une menace extérieure et lointaine, extérieure à nous, mais qu’elles sont toutes proches de nous et émanent de nous-mêmes, êtres humains. Elles me sont ainsi plus familières et moins effrayantes » (p. 107)
Elle refuse la projection du mal à l’extérieur, elle le reconnaît en l’homme, en elle aussi, dans une lucidité sans ressentiment.
Faisant partie des fonctionnaires envoyés par le Conseil Juif à Westerbork, un camp de transit pour les déportés avant leur acheminement vers les camps de la mort, elle fait plusieurs allers-retours entre Amsterdam où elle tient son journal, et Westerbork d’où elle envoie ses lettres.
Le conte d’Etty
À travers ses écrits, Etty semble écrire un conte, l’histoire d’une transformation. Elle traverse une tragédie, mais au lieu de se refermer, elle s’ouvre à elle-même, aux autres, au divin :
« Quelle étrange histoire, tout de même, que la mienne, celle de la fille qui ne savait pas s’agenouiller. Ou variante – de la fille qui a appris à prier. » (p. 242)
Cette phrase, à la fois simple et bouleversante, résume à elle seule la nature de son parcours : une conversion non religieuse, mais existentielle, qui lui permet d’entrer dans une relation vivante au monde et à son destin. Etty n’a pas fui son époque, ni les camps. Elle n’a fui ni ses responsabilités, ni sa propre fragilité. Elle a habité chaque instant de sa vie, même les plus terribles, avec une intensité intérieure qui force l’admiration.
Ainsi, elle a puisé dans cette intériorité une forme de résistance. Pas une résistance politique ou militaire, mais une résistance de l’âme, ancrée dans une foi inébranlable en la vie, en l’humain.
La lumière dans l’abîme
Les Lettres de Westerbork, écrites entre juillet 1943 et septembre 1943, sont d’une rare intensité. Etty y décrit avec un grand calme la réalité du camp, les convois vers Auschwitz, les enfants, les familles. Son regard ne cesse d’être tendre, doux, attentif aux autres. Même lorsqu’elle sait que la mort approche, son ton reste paisible. Dans sa dernière lettre, avant son départ avec ses parents et l’un de ses frères dans un convoi dont nul ne reviendra, elle écrit simplement, laissant une ouverture sur l’avenir :
« Au revoir de nous quatre. » (p. 345)
Cette simplicité n’est pas une résignation, c’est une acceptation totale, une conscience pleine et éveillée jusqu’à la fin. Elle n’idéalise pas, elle voit. Mais elle ne se laisse pas écraser.
Etty Hillesum et Sabina Spielrein en miroir
Si tout semble opposer Etty Hillesum (1914–1943) et Sabina Spielrein (1885–1942), à commencer par leur différence d’âge et de trajectoire, un regard attentif laisse entrevoir des résonances profondes. Juives toutes deux, nées dans des familles bourgeoises cultivées, elles partagent une passion pour la langue russe et un même attrait pour l’introspection, nourri par une relation amoureuse : Carl Gustav Jung pour Sabina et Julius Spier (formé par Jung) pour Etty.
Brillantes, sensibles, exigeantes envers elles-mêmes, elles se sont engagées sur un chemin intérieur intensément vécu. Conscientes du danger, elles poursuivent leur destinée avec une lucidité tragique, sans céder aux appels de leurs proches ni à la tentation de fuir. Toutes deux seront broyées à quelques mois d’intervalle par la barbarie nazie, l’une à Rostov-sur-le-Don, l’autre à Auschwitz, dans une Europe dévastée.
Leurs écrits, retrouvés bien après leur mort, résonnent aujourd’hui comme des témoignages essentiels. Leur mise en regard éclaire, en creux, les différentes issues d’un travail intérieur confronté à l’histoire et à l’inconscient.
Jean-Pierre Robert, dans son article Sabina Spielrein fascine !, s’appuie sur le type psychologique de Sabina Spielrein tel qu’il se dégage de ses propres écrits et de ses confidences. De son côté, Etty Hillesum exprime avec clarté ce qui, en elle, résiste à une domination par la pensée :
« Ce n’est pas de penser qui me tirera d’affaire. Penser, c’est une grande et belle occupation dans les études, mais ce n’est pas ce qui vous tire de situations psychologiques difficiles. […] On ne peut dominer par la raison, laissons dont les fontaines du sentiment et de l’intuition jaillir un peu elle aussi ». (p. 58).
À travers ces quelques lignes, on mesure combien leurs cheminements intérieurs, bien que menés dans des contextes très différents, s’appuient sur une même sensibilité structurante.
L’individuation comme acte de vie
Jung parlait de l’individuation comme du processus par lequel l’être humain devient ce qu’il est, en assumant les tensions contraires, en intégrant l’ombre, en s’ouvrant au Soi. Etty Hillesum nous offre une lecture personnelle de ce chemin : à la fois ancrée dans son époque et connectée à une réalité intérieure transcendante.
Lire Etty Hillesum aujourd’hui, c’est entendre la voix d’une femme qui a accompli, dans les circonstances les plus extrêmes, un travail intérieur d’une puissance rare. Son journal n’est pas seulement un témoignage historique, c’est un acte de vie.
Éditeur : Points – 2025 – 408 pages – ISBN 9782757885727– 10,9 x 17,9 x 2 cm (poche)
Août 2025